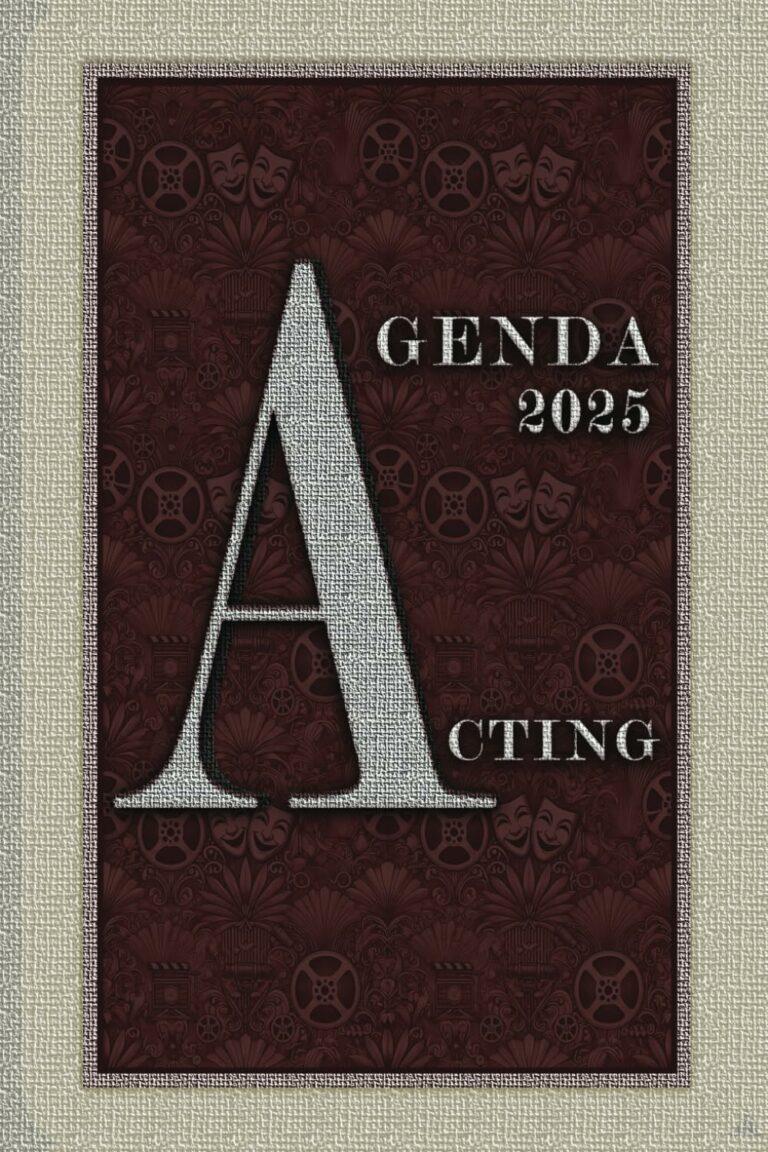Production audiovisuelle, le calme avant la révolution ?
source de cette article : https://alain.le-diberder.com/production-audiovisuelle-le-calme-avant-la-revolution/
L’audiovisuel dans son ensemble vit une période de bouleversements technologiques et économiques qui en distordent les équilibres : internationalisation très rapide, irruption d’entreprises technologiques, mutation des habitudes de consommation, stagnation globale des ressources. Pourtant la production de programmes qui en constitue le cœur du point de vue éditorial semble à l’abri de la tempête, en tout cas ses éventuels soubresauts ne défraient pas la chronique. Sagesse des femmes et des hommes de contenus regardant placidement passer les « révolutions » chez leurs clients tout en sachant qu’à la fin ils vont ramasser la mise ? Ou bien inconscience d’un domaine protégé par une forteresse réglementaire le gardant à l’abri, pour l’instant, des violences du marché ? Probablement les derniers instants d’un éco-système mis en place dans les années quatre-vingt et qui doit et qui peut se transformer en profondeur.
1 : La production audiovisuelle, combien de divisions ?
Les habitués des salles de cinéma connaissent la marguerite de Gaumont, le WB de Warner et bien sûr les logos Disney. Mais les dizaines de millions de téléspectateurs ne connaissent ni Newen, ni Tetra media, ni Les Films d’Ici ni Eléphant, dont pourtant ils regardent les productions tous les jours. C’est qu’il existe, en théorie, près de 4000 entreprises de production audiovisuelle en France (contre 500 au Royaume-Uni pour un marché deux fois plus grand) mais aucune « major ». Le secteur, à peu près regroupé dans les branches 5911A et B de la nomenclature d’activités de l’INSEE, peut être divisé en sept catégories officiellement reconnues mais auxquelles il faut désormais ajouter une « petite » nouvelle :
- La production de fictions (séries, téléfilms unitaires) constitue l’aristocratie du secteur, par sa proximité culturelle (mais pas économique) avec le cinéma. De nombreux réalisateurs, comédiens et scénaristes ont eu et ont encore en effet un parcours au cinéma et à la télévision. Même Orson Welles a réalisé un « téléfilm » pour la télévision française[1]. En termes de chiffre d’affaires, avec environ 800 millions d’euros en 2017, la fiction représente plus du quart de l’ensemble du domaine, 60% des dépenses des chaînes en programmes français inédits, et un quart des aides du CNC. Les auteurs de fiction sont représentés par la SACD. Jusqu’en 2012 les exportations françaises de programmes de fiction étaient anecdotiques, de l’ordre d’une vingtaine de millions d’euros, mais elles ont triplé depuis et ont dépassé en 2017 les 63 millions d’euros.
- Les documentaires arrivent en seconde place dans l’ordre du prestige comme dans celui des attentions des pouvoirs publics. Avec environ 400 millions d’euros en 2017 les documentaires perçoivent autant d’aides que la fiction (environ 80 millions d’euros). Les auteurs de documentaires relèvent de la SCAM (société des auteurs multimédias).
- Les producteurs d’émissions de flux (téléréalité, talkshows, variétés, jeux) sont pour la plupart regroupés dans un syndicat professionnel, le SPECT, qui revendique pour ses membres un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2016, ce qui en ferait avec un tiers du total, la plus grande composante du domaine en termes économiques. Cette activité, qui ne bénéficie pratiquement pas d’aides du CNC, a une bien moins bonne réputation politique. Il s’agit d’émissions qui pour la plupart reposent sur la notoriété d’un animateur et la vieille affaire des « voleurs de patates » a laissé des traces. Les exportations de ce domaine sont faibles, de l’ordre de 20 millions d’euros par an sous forme de format (Fort Boyard par exemple) et stagnent depuis 2012.
- Les films d’animation pour la télévision pourraient être agrégés à la fiction, dont ils constituent bel et bien un sous-genre, mais leurs techniques et leur économie sont très différentes. Avec une production probablement de l’ordre de 280 millions d’euros en 2017, ils bénéficiaient de 58 millions d’aides du CNC. Cette même année les exportations françaises de programmes d’animation ont atteint 75 millions d’euros, soit plus que les commandes des chaines ou que les aides versées par le compte de soutien du CNC au secteur.
- Les captations de spectacles vivants (sports, concerts, théâtre, danse) sont également un domaine à part. Bénéficiant d’engagements de certaines chaînes dans le cadre de leur cahier des charges ou de leur convention d’autorisation avec le CSA, la partie culturelle de ces émissions est produite par quelques entreprises spécialisées. Elle est aidée par le CNC et pèse environ 120 millions d’euros, mais il faudrait y ajouter le chiffre d’affaires, considérable, des captations qui ne sont pas éligibles, les retransmissions sportives et les spectacles pour lesquels il n’y a pas de diffuseur télévisuel (cas des captations destinées uniquement à la vidéo) ou qui ne correspondent pas aux critères d’aide.
- Les magazines ont un statut à part. Pour une majorité d’entre eux ils sont considérés comme des émissions de flux, donc non aidés par le CNC car ne comptant pas comme œuvre audiovisuelle à valeur patrimoniale. La petite partie aidée représente un chiffre d’affaires d’environ 30 millions de chiffre d’affaires. La partie non-aidée appartient à la catégorie des émissions de flux.
- L’information est un domaine considérable mais pour lequel il est bien difficile de trouver des informations économiques cohérentes. Il existe bien des producteurs spécialisés, comme CAPA, mais la plus grande partie des programmes d’information est réalisée en interne par les chaines disposant d’une rédaction : chaînes d’information en continu et grandes chaînes historiques pour l’information générale et chaînes sportives ou thématiques pour le reste. Sans oublier le plus gros employeur de journalistes audiovisuels français, à savoir les stations régionales de France 3. La commission de la carte de journaliste estime qu’environ 19% des quelques 35000 titulaires d’une carte de journaliste travaillent soit dans une chaîne de télévision (c’est l’essentiel soit environ 5500 emplois, dont la moitié chez France Télévision) soit chez un producteur audiovisuel ou une agence.
- La production institutionnelle constitue un ensemble encore moins bien cerné. Il s’agit de films dit « d’entreprise », soit de formation, soit de promotion, qui n’ont en général pas de distribution autre qu’interne dans une société. Ce domaine est prospère mais très opaque et hétérogène. Il peut recouvrir des films dont les plus ambitieux pourraient apparaître comme d’authentiques documentaires, mais aussi de simples présentations Powerpoint un peu luxueuses, en passant par des talk shows présentés par des animateurs ou journalistes faisant des « ménages ». Cela étant ce domaine peu prestigieux emploie une bonne partie des techniciens (cadreurs, techniciens du son, monteurs) du domaine. La production des spots publicitaires fait en principe également partie de la production institutionnelle (5911B) selon la nomenclature de l’INSEE.
- La dernière composante du domaine, la plus récente, est celle des vidéos réalisées pour les plateformes vidéo, YouTube essentiellement mais aussi Dailymotion ou Viméo. Il s’agit au départ de productions réalisées par des non-professionnels (User Generated Content), bien que les youtubeurs les plus connus intègrent tôt ou tard des structures de production professionnelles comme Golden Moustache du groupe M6 ou Mixicom du groupe Webedia (Norman, Cyprien, Squeezie…). Les contours de ce domaine sont rarement décrits mais sûrement en rapide croissance, tant par leur audience, les effectifs concernés que par leur économie. On recensait à l’été 2018 65 Youtubeurs français ayant obtenus plus de 500 millions de vidéos vues (au sens, très tolérant, de YouTube). Le nombre de personnes produisant des vidéos sur ces plateformes semble sans commune mesure avec les effectifs de la production audiovisuelle. YouTube parle de 3 millions de « partenaires » en Europe, c’est-à-dire de titulaires de comptes actifs chargeant régulièrement des vidéos. Si la France représentait 10% de ce total, cela voudrait dire qu’il y aurait en France trois fois plus de personnes produisant de la vidéo pour Youtube, faisant donc du montage et du mixage son, que d’emplois dans la production « officielle ».
Au total ces huit formes de production audiovisuelles présentent des modèles économiques, des cadres réglementaires et des traditions culturelles très différents, même s’ils ont quelques points communs. Pour ajouter à la confusion, les frontières entre ces domaines ne sont pas totalement étanches. Il existe par exemple pour l’information un continuum qui va des reportages destinés aux journaux télévisés jusqu’au documentaires en passant par les magazines, avec des franges discutées. D’une manière générale la frontière entre documentaires et magazines est poreuse, comme celle entre ces derniers et les émissions de flux. Certains Youtubeurs ont déjà intégré la production de flux pour la « vraie » télévision. Mais du point de vue de l’emploi et des qualifications, le domaine possède une réelle consistance : monteurs, cadreurs, réalisateurs, auteurs, journalistes, commerciaux, juristes peuvent passer sans difficulté d’un sous-secteur à l’autre et ne s’en privent pas. L’ensemble de ce bassin d’emploi représentait environ 90.000 équivalents temps plein en 2017, trois fois plus que le nombre d’emplois des chaînes de télévision.
2 : Un long fleuve tranquille. Jusqu’à présent.
La relative stabilité du domaine peut s’illustrer de plusieurs façons. La première est celle des entreprises. Le CSA a publié en septembre 2018 la troisième édition de son étude sur le tissu économique du secteur de la production audiovisuelle fondée notamment sur des données de l’INSEE et d’Audiens. A sa lecture, la première impression est celle d’un dynamisme apparent : le nombre d’entreprises est considérable (4000 environ) et il continue, quoique faiblement, à croître. Mais en réalité les producteurs installés trustent près des deux tiers du chiffre d’affaires du secteur. Encore le critère d’ancienneté retenu (entreprise créée depuis plus de dix ans) laisse de côté le cas des producteurs chevronnés qui ont créé plus récemment une nouvelle entreprise. Le secteur est à la fois peu concentré puisque les dix plus grosses sociétés ne captent que 16% du marché, et finalement relativement fermé puisque les « nouveaux venus », les producteurs apparus dans les années 2000, doivent sans doute se contenter de moins de 20% du total. Mais le chiffre étonnant de 4000 entreprises françaises (dont moins de 1000 réellement actives) cache le fait que la production audiovisuelle française est animée par au mieux une centaine de personnes, pour la plupart entrées dans le secteur il y a plus de 25 ans.
Le deuxième élément de stabilité est révélé par les données du CNC sur la production aidée, c’est-à-dire à peu près la moitié de l’économie du secteur. On constate une triple stabilité. La première est celle du volume d’heures produites : 4873 heures en 2017, à peu près comme en 2011 (4850 heures). Ce chiffre fluctue d’une année sur l’autre et avait augmenté avec la montée en charge des nouvelles chaînes de la TNT dans la deuxième moitié des années 2000, mais il ne bouge globalement plus depuis. La seconde stabilité concerne la répartition par genres. Depuis 2010, la moitié des dépenses va aux fictions, un quart aux documentaires, un peu plus de 15% à l’animation et les spectacles et les magazines culturels se partagent les 10% restants. Cette structure ne bouge pas beaucoup d’années en années. La stabilité de ces deux paramètres, le volume d’heures et sa structure par genre – on pourrait parler de stagnation ou d’immobilisme – ne doit pas grand-chose à un quelconque conservatisme des producteurs, maïs beaucoup aux rigidités introduites par la réglementation des chaînes : entre les cahiers des charges courtelinesques des chaînes publiques et les multiples clauses des conventions des chaînes privées, il y a peu de marges de manœuvre. Enfin la troisième stabilité est celle des postes de devis. On la connait bien pour la fiction : en 2017 les dépenses de personnel représentaient 23% des devis, comme en 2008, les dépenses en droits artistiques 7%, l’interprétation 12%, les décors et costumes 8%, en 2017 comme dix ans auparavant.
Ainsi donc en France on produit depuis dix ans le même volume d’œuvres, avec les mêmes devis, et les mêmes producteurs. Avec grosso modo le même cadre réglementaire. Il s’agit là d’un point de vue de Sirius, d’un résumé grossier, qui néglige l’écume des mini-réformes, de quelques mini-tendances et de quelques changements du capital de quelques producteurs. Mais l’arbre de ces péripéties ne doit pas cacher l’impressionnante stabilité de la forêt. Qui contraste avec les tempêtes du reste du domaine audiovisuel.
3 : Le cœur du cœur du secteur, la marge des producteurs
La marge des producteurs audiovisuels a mauvaise réputation et c’est en grande partie injuste. Le scandale des contrats très favorables accordés par France Télévision à quelques animateurs-producteurs, dénoncés à plusieurs reprises par la Cour des Comptes, a fait circuler des chiffres en effet étonnants : 50%, voire 65% pour certains animateurs! Chiffres qui ont été d’ailleurs vivement contestés par les intéressés. La réalité est naturellement plus complexe.
Il est d’abord vrai qu’un producteur dispose d’une grande marge de manœuvre pour présenter ses comptes, bien plus que la plupart des autres fournisseurs des chaînes de télévision. Le poste « imprévus » qui figure à la fin des devis, la possibilité de se salarier ou de salarier des proches, les imputations difficilement vérifiables du temps passé par certains collaborateurs travaillant sur plusieurs émissions, les facturations à des entreprises amies avec des rétro-commissions, la connivence avec les chargés de programmes ou responsables d’unités, le clavier des carambouilles potentielles comporte ainsi de nombreuses touches. Et il y a incontestablement eu quelques virtuoses. Mais la citation de La Cité de la Peur, d’Alain Berberian s’applique parfaitement ici : « on peut tromper une personne mille fois, mille personnes une fois, mais on ne peut pas tromper mille personnes mille fois ». En fait la tactique des devis avec forte marge n’a jamais pu constituer une stratégie d’entreprise soutenable à moyen terme. La marge tolérable en moyenne a été régulée tacitement dans le secteur entre les plus gros diffuseurs et les plus gros producteurs, sans tambours ni trompettes mais avec efficacité.
Par ailleurs, tout au long des années 2000, les dispositifs de contrôle se sont multipliés et renforcés : reddition des comptes avec retenue sur un pourcentage du paiement, audit des comptes, contrôles de devis par le CNC, mises en concurrence plus fréquentes. La raison principale n’était pas de « moraliser » le secteur mais de trouver des formes traduisant la stagnation, puis la baisse, des ressources des diffuseurs.
La marge des producteurs est donc une des variables d’ajustement, de régulation, du marché audiovisuel dans son ensemble. L’évolution des prix auxquels se vend la production est à cet égard éloquente. Tous genres confondus une heure produite avait un devis de 315000 euros en 2017 contre 333000 en 2007, soit une baisse de près de 6%. En outre dans le même temps l’inflation a été d’environ 14%. Pour la fiction seule, le coût horaire est passé de 857000 euros en 2007 à 827000 en 2017, soit une baisse de 4%. Comme on l’a vu, la structure des devis étant restée stable, en tout cas pour la fiction, cette baisse des prix de l’ordre de 20% en euros constants n’a pas pu être absorbée par des changements de méthodes de production. Elle s’est très probablement traduite principalement par des baisses des marges des producteurs et non par une réduction de la masse salariale, laquelle semble selon Audiens avoir cru encore d’environ 10% entre 2011 et 2016.

Source : étude publiée par le CSA déjà citée
La baisse des recettes annuelles des chaînes privées, de l’ordre de 450 millions d’euros par an entre 2011 et 2017, a été à moitié absorbée par une baisse de la rentabilité des diffuseurs. Mais l’autre moitié des baisses de ressources a été compensée d’une part par des baisses de coûts fixes (diffusion, effectifs des chaînes) et d’autre part par une baisse des dépenses de programmes de flux. L’étude du CSA évoque une diminution sur la période de 2 à 50% (la fourchette est large) du prix à la minute payé par les chaînes, à quoi s’ajoute une tendance à la réduction du volume annuel, une saison typique d’un programme de flux tendant à passer de 40 à 36 semaines.
Au total donc le domaine semble très stable, vu de l’extérieur, mais cette stabilité se paie par des baisses générales des prix unitaires, ainsi que des marges des producteurs.
4 : Un risque élevé d’importantes baisses de ressources sur le marché français
Le secteur de la production audiovisuelle français est donc un système fluide, doté d’une forte stabilité structurelle reposant sur un tissu d’entreprises moyennes ou petites aux faibles coûts de structure. Dans cette industrie de main d’œuvre, le recours massif aux contrats précaires (intermittents du spectacle et CDD d’usage) est un rêve de manuel d’économie néo-libéral permettant une absence de « rigidités » et une adaptation rapide, permanente, des capacités de production aux commandes réelles. Le « goodwill » d’une entreprise est ici essentiellement immatériel, c’est en fait le carnet d’adresses de son ou de ses dirigeants. Le cœur du secteur reste cependant dépendant à 85% des chaînes de télévision et donc de leur économie. Ce n’est pas un problème pour tout le monde, par exemple pour le nouveau domaine de la production pour les plateformes vidéo, ni bien sûr pour la production institutionnelle. Mais pour les six autres composantes du secteur, la fiction, les documentaires, les magazines, les émissions de flux, les captations de spectacles et l’animation, la télévision traditionnelle est presque le seul client. Or tout laisse à penser que les ressources globales de ce client vont continuer à baisser. Il peut y avoir des interruptions passagères de la tendance, par exemple avec une réglementation plus favorable pour la publicité télévisuelle, mais à long terme cela ne changera pas grand-chose : la redevance, les abonnements à des services payants produisant significativement en France, tout va baisser. Et on n’augmentera pas les obligations des chaînes, au contraire. France Télévision en particulier (50% des contributions totales) doit se contenter de promettre de « sanctuariser » ses dépenses de programmes de « création » jusqu’en 2022. La traduction en français courant du terme techno-politique « sanctuariser » est bien connue: ce qui est sanctuarisé ne peut pas monter et ne peut donc que baisser. Seule la folie réglementariste des lobbys peut faire espérer qu’Amazon ou Netflix deviennent un jour des substituts à Canal+. En réalité un Euro qui part de Canal+ pour aller à Netflix c’est 15 centimes de moins pour la production audiovisuelle et cinématographique française.
Dans un contexte de restrictions des financements publics et de baisses des audiences aux heures de grande écoute, il n’est donc pas pessimiste d’envisager une baisse des ressources en provenance des télévisions, directement (commandes) et indirectement via les contributions au COSIP (et aux sociétés d’auteurs), de l’ordre de 3 à 5% par an en moyenne. Pendant un certain temps cette diminution, dont les prémisses ont déjà été observées au cours des années 10, pourrait être absorbable par la majorité des producteurs. Mais une baisse régulière et prolongée est peu probable, il y aura des décrochages, des accidents. Des scénarios inenvisageables il y a quelques années ne le sont plus : la fusion de TF1 et de M6 pour ne plus former qu’un seul groupe privé de télévision généraliste français comme c’est le cas en Grande-Bretagne (ITV), en Espagne (Antena 3) ou en Italie (Médiaset), l’abandon par Canal+ de son réseau hertzien ou son rachat par un groupe américain pourraient ainsi s’accompagner d’une révision considérablement à la baisse de leurs engagements de production. Le risque existe. La production française d’œuvres correspond aujourd’hui à un cumul de devis d’1,5 milliards d’euros dont les deux tiers, un milliard, proviennent directement ou indirectement des télés. Les télévisons permettent en outre, via leurs cotisations à la SACD le versement de 165 millions d’euros directement aux auteurs. Une baisse de 5% par an jusqu’en 2024 signifierait à terme un manque à investir dans la production de 300 millions d’euros par an, et une baisse des reversements aux auteurs de 50 millions. Comment y faire face ?
5 : Un contexte international favorable
La situation sur le marché mondial contraste violemment avec celle de la France. Sous l’influence des plateformes de svod, actuelles ou futures, la période est au contraire à une explosion des volumes de production, des sommes investies, des rémunérations des « talents » et à la constitution de groupes mondiaux intégrant la production et la distribution. C’est le domaine des séries télévisuelles qui est au cœur de ce maelstrom. Voici les estimations par le cabinet Ampere du nombre de séries en cours de production dans les pays occidentaux en 2019:

La production de séries de 52 minutes par épisode en France était selon le CNC de l’ordre de 416 épisodes en 2017, soit environ 52 séries, chiffre cohérent avec l’estimation d’Ampere de 27 séries pour France télévisions dans le graphique ci-dessus.
Les investissements dans ce domaine sont eux-mêmes colossaux. Pour ne pas prendre un exemple extrême, Apple s’est engagée dans la commande d’une série avec Jennifer Aniston pour un budget de 10 millions de dollars par épisode. Dans le même temps le budget moyen d’une fiction de 52 minutes en France était d’1,4 millions d’euros en 2017. Peut-être le plus parlant est-il l’explosion des contrats proposés aux « showrunners » (auteurs-producteurs de séries) en 2017 et 2018 :

Ces sommes défiant l’imagination en Europe sont toutefois à (légèrement) nuancer car elles portent désormais sur l’ensemble des droits, dans le temps et dans l’espace, des séries à venir. Dans l’ancien système, le showrunner était également bien payé (10 millions de dollars par an pour Shonda Rhimes chez ABC avant son deal avec Netflix) mais conservait des droits proportionnels sur les futures exploitations. Du moins en théorie, car un récent conflit entre Fox et les acteurs et créateurs de la série Bones a été arbitré en défaveur de Fox (amende de 179 millions de dollars) mais a surtout mis crûment en lumière ce qui s’appelle joliment le « Hollywood accouting » qui consiste en gros à arranger les comptes de sorte que les ventes de programmes ne semblent jamais suffisantes pour que le programme soit amorti. Sociétés écrans amies chargées de la promotion du programme à prix d’or, ventes sous-valorisées à des filiales, tout est bon et largement pratiqué, pas seulement par Fox. C’est ainsi qu’officiellement le Retour du Jedi (32 M$ de coût, 475 M$ de recettes en salles) n’est toujours pas considéré comme rentable par LucasFilm, de même que Warner ne trouvait pas que les 940 M$ au box office d’Harry Potter et l’ordre du Phénix puisse permettre de rentabiliser les 150 M$ de budget du film et donc de verser des royalties aux ayant-droits (voir un excellent article sur Allociné à ce sujet). Dans ces conditions on comprend que certains talents d’Hollywood acceptent de lâcher l’ombre des recettes proportionnelles potentielles pour la proie d’un fixe très élevé.
Mais cette intégration des producteurs dans les plateformes de diffusion ne concerne pas que les fictions. Dans les programmes de flux, le groupe Endemol, racheté pour 5,5 milliards d’euros par Telefonica en 2000, puis revendu pour un peu plus de la moitié de cette somme à Mediaset (Berlusconi) en 2007, a été ensuite fusionné avec Shine (Murdoch) en 2014 et cherche à se vendre depuis 2018. Endemol sera probablement racheté par une plateforme. Les groupes européens de télévision ont eux aussi renforcé leurs positions dans la production. Certains y étaient présents depuis longtemps comme RTL Group avec Fremantle, ou ITV (Granada) qui a en outre acquis le hollandais Talpa (The Voice) et en France Tetra Media (Un Village Français). En Espagne la chaîne Antena 3 est présente dans la production, notamment pour les premières saisons de La Casa de Papel. En France TF1 a racheté Newen (Plus belle la vie) et en janvier 2019, Mediawan après avoir racheté le groupe AB a acquis Palomar, le leader italien de la fiction. Les grandes manœuvres continuent avec le rachat d’Elephant (Emmanuel Chain) par Webedia (Allociné, jeuvideo.com) pour constituer un groupe tourné vers l’exportation.
Car le marché international est désormais la seule issue possible à la crise à venir des financements traditionnels de la production française. En 2017 les 325 millions de ressources trouvées à l’international représentaient environ 10% de l’économie du domaine. D’ici cinq ans il faudrait doubler ce montant pour compenser une baisse de 5% par an des ressources des chaînes de télévision. Ce n’est pas impossible, et le dynamisme du marché international s’y prête, mais il restera à résoudre deux problèmes :
- Pour l’instant la croissance des exportations est portée par des distributeurs et des producteurs qui disposent des droits des programmes à l’international. Que se passera-t-il si les aménagements du cadre réglementaire de la télévision font remonter ces droits aux diffuseurs ?
- Si les diffuseurs apportent 300 millions d’euros de moins par an à la production du fait de la diminution de leurs ressources mais que cette perte est compensée par les exportations, il restera que cette substitution n’est pas neutre pour les auteurs. Il serait paradoxal qu’au moment où Hollywood paie mieux les auteurs l’évolution du marché français prenne le chemin inverse.
6 : Produire autrement
Le numérique n’a pas que des conséquences économiques sur la production audiovisuelle. Il change aussi, lentement mais profondément, la manière de produire. Le mouvement le plus important porte sur la dilution des formats de durée. Ceux-ci, depuis trois quarts de siècles, étaient imposés par les contraintes de programmation des chaînes linéaires. Pour proposer des rendez-vous faciles à mémoriser par les téléspectateurs on visait des heures pleines et, comme il fallait bien placer de la publicité, l’heure télé faisait 52 minutes, la demi-heure 26 minutes, et les programmes longs l’étaient autant qu’un film de cinéma, c’est-à-dire en gros 90 minutes. Mais la dissolution du broadcasting dans la télévision distribuée, à la demande, desserre ces contraintes. On peut, on doit, être plus court sur YouTube ou les réseaux sociaux, on peut être beaucoup plus long sur Netflix. Et en effet depuis 2015 le centre de gravité économique des séries américaines et britanniques s’est déplacé des chaînes de télévision vers les services de svod, Netflix et Amazon en tête. Le tableau suivant montre les évolutions récentes de la durée des épisodes de deux séries emblématiques, Game Of Thrones (HBO) et Black Mirror (Channel 4 puis Netflix) qui avaient commencé leur carrière sur une chaîne linéaire, et l’ont poursuivi en streaming:

Ce « déformatage », on pourrait parler de « défenestration » puisqu’il fait craquer les fenêtres des grilles de télévisons classiques, les cases, prend également d’autre formes, en particulier avec les séries documentaires très longues, extrêmement difficiles à programmer proprement en télévision linéaire. Un exemple récent étant la série-événement de Ken Burns sur le Vietnam produite par PBS en 18 épisodes et reformatée par Arte en 9 fois une heure. Les plateformes de svod n’ont aucun mal à exposer ce type de programmes et s’y engagent de plus en plus. A la grande joie des auteurs.
Pour les auteurs français il y a cependant un problème. Pour le cinéma et la fiction, le système français prévoit qu’un auteur (un scénariste, un réalisateur) perçoit deux types de rémunération : la première versée à la commande de l’œuvre par le producteur, et une seconde lors de sa diffusion, versée par la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)[2]. Les sociétés d’auteurs ont des contrats avec les diffuseurs auprès desquels elles perçoivent une rémunération globale en pourcentage de leur chiffre d’affaire (généralement entre 3 et 4%). Cette somme est ensuite reversée aux auteurs en fonction d’un système sophistiqué qui s’appelle le barème. Ce barème, longuement négocié entre les représentants des auteurs, répartit les sommes d’une part entre les différents types d’auteurs et d‘autre part en fonction du type de diffusion. Un film passant pour la première fois en prime time sur TF1 rapporte plus de points qu’une énième diffusion sur une petite chaîne de la TNT. Parfois qualifiée d’usine à gaz opaque cette méthode est en fait très ingénieuse. Elle permet de concilier un des principes de base du droit d’auteur depuis sa création par Beaumarchais en 1793 selon lequel un auteur doit participer au succès public de son œuvre, tout en n’étant pas strictement proportionnelle à l’audience de cette œuvre à la télévision. En effet le succès d’audience mesuré par Médiamétrie ne dépend pas que des qualités du programme mais aussi de la manière dont il a été programmé et de ce que proposait la concurrence à ce moment-là. La rémunération des auteurs, pour cette deuxième composante de leurs ressources, n’est donc pas directement proportionnelle ni au devis du film ni à son audience.
Bien que peu connu du grand public, ce système est une pièce essentielle du fonctionnement de l’audiovisuel français. Et il ne s’agit pas de petites sommes. En 2017, la SACD a perçu 165,5 millions d’euros venant de l’audiovisuel. A ce titre, des sommes ont été versées à 15100 auteurs, dont 600 ayant perçu plus de 50.000 euros.
Le développement de la svod et de la télévision de rattrapage ne menace pas le montant des sommes perçues par les sociétés d’auteurs, puisque, bon gré mal gré, les directives européennes et le droit français contraignent les plateformes en ligne à contribuer comme les autres types de diffuseurs audiovisuels. Netflix avait par exemple signé un accord avec la SACD dès 2014. Mais le problème va être de savoir comment répartir ces sommes entre les auteurs. Le fameux « barème » en fonction des heures de diffusion ne va s’appliquer qu’à une part sans cesse décroissante de l’audience. La SACD s’est déjà adaptée à cette situation en passant un accord remarquable avec Netflix au terme duquel celle-ci lui communique les données nécessaires à une répartition raisonnable. Mais les autres services américains d’une part et les offres de télévision de rattrapage ne sont pas dans ce cas. Tant que la svod et le replay ne représentent qu’un faible pourcentage de l’audience et des recettes de l’audiovisuel, tous les bricolages sont possibles, mais à terme les sociétés d’auteurs vont devoir réinventer leur modèle de répartition.
Ailleurs en Europe, où les organisations d’auteurs n’ont pas le même pouvoir de négociation que la SACD française, les choses se passent parfois mal avec le système dit de « buy out » pratiqué par Netflix ou HBO. Il consiste à acheter tous les droits d‘un coup, au moment de la signature du contrat, sans avoir à reverser des royalties ultérieurement en fonction de l’exploitation de l’œuvre. Ainsi au Danemark les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs se sont groupés à l’automne 2018 pour refuser tout contrat avec Netflix qui ne respecterait pas les accord collectifs danois qui prévoient un versement de royalties en fonction de l’exploitation de l’œuvre.
A l’autre extrémité de l’éventail des production audiovisuelles, pour les programmes courts, plébiscités en ligne par les plus jeunes sur YouTube ou pour les reportages, les évolutions techniques sont en train de transformer radicalement les métiers. Oui, on peut faire des sujets convenables avec un smartphone, y compris le montage. Les jeunes recrues qui pigent pour les rédactions audiovisuelles font enrager les journalistes quinquagénaires accrochés aux termes des accords d’entreprise ou de la convention collective. Non, il n’est plus nécessaire partir à trois avec un journaliste, un cadreur avec sa caisse de 30 kilos et un sondier. Oui, les écoles forment des « réalisateurs » qui font aussi le cadrage, le montage et la lumière. Des journalistes montent et des monteurs écrivent. Plus loin les progrès de l’intelligence artificielle permettent sinon de faire du montage automatique, mais en tout cas du dérushage assisté par ordinateur. Voir par exemple le programme Magisto ou les services de start-ups comme Wibbitz ou Gliacloud, sans compter les outils proposés par Microsoft, Google ou Amazon. Le sous-titrage commence à être fait par des logiciels comme videodubber, et il en existe une dizaine d’autres. On peut être sceptique devant les promesses de méthodes de Deep Learning capables d’écrire des scénarios à partir de bases de données, mais il est évident que la veille technologique sur ces domaines est aujourd’hui une nécessité professionnelle pour la production audiovisuelle française.
7 : Que faire ?
La première question est celle de l’évolution probable de la réglementation qui risque de donner plus de poids aux diffuseurs dans la détention de droits. Sur le marché intérieur français, les arguments des chaînes sont solides quand elles veulent éviter de retrouver une part croissante de leurs propres programmes sur les plateformes américaines et elles finiront par être écoutées. Mais il serait indispensable que les producteurs conservent au moins les droits internationaux et en fassent un axe majeur de leur développement. On peut douter en effet que des diffuseurs historiquement et culturellement concentrés sur le marché national soient les meilleurs pour exporter les programmes français. Il n’y a pas en France de BBC Worldwide.
Le second axe est celui du niveau technologique de la production française. Mais aucune entreprise du secteur n’a la taille suffisante pour une réelle stratégie de R&D. Et la tradition du domaine n’est pas dans la mise en commun de savoir-faire. Les improvisations pragmatiques, les occasions qui font le larron, ne laissent pas le secteur sans ressources et il comprend de nombreux innovateurs parfois pointus, mais on est tout de même loin d’une véritable stratégie industrielle.
Le secteur a suffisamment d’arguments pour inciter à l’optimisme, mais ne mesure peut-être pas assez que sans une internationalisation rapide et sans innovations de procédé, le risque de l’étiolement dans un cadre réglementaire administrant la pénurie est bien réel.
Alain Le Diberder